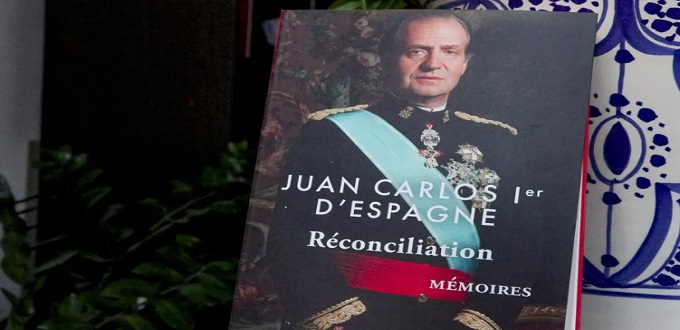L’enseignement comme solution durable à nos crises

Chaque 5 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de l’enseignant, instituée par l’UNESCO et l’Organisation internationale du Travail en 1994 pour rendre hommage à ceux qui façonnent l’avenir par la connaissance et la transmission du savoir. Cet événement n’est pas seulement commémoratif : il invite à une réflexion profonde sur le rôle crucial de l’éducation dans la résolution des crises sociales, économiques, politiques et culturelles que traversent nos sociétés contemporaines. L’enseignement n’est pas un simple levier de progrès ; il constitue, à bien des égards, la solution la plus durable et la plus éthique à nos déséquilibres collectifs (UNESCO, 2024).
L’histoire des nations démontre que les sociétés qui ont investi dans l’éducation ont su surmonter leurs crises les plus profondes. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a bâti son redressement sur la formation rigoureuse, la discipline intellectuelle et la valorisation de l’enseignant comme pilier du développement (Dore, 1976). Ce pays, en misant sur un système éducatif centré sur la qualité et la recherche, a transformé un échec historique en un modèle d’innovation et de prospérité. De même, la Corée du Sud, confrontée à la pauvreté et à la guerre dans les années 1950, a fait du savoir une ressource nationale. En 1960, son taux d’alphabétisation dépassait à peine 50 %, mais à force d’investissements constants dans la formation des maîtres et la scolarisation universelle, elle est devenue, en moins d’un demi-siècle, une économie du savoir parmi les plus compétitives au monde (World Bank, 2019).
Les pays nordiques, tels que la Finlande, la Suède et la Norvège, ont également démontré que l’éducation pouvait être la clé d’un équilibre social durable. Leur modèle repose sur la confiance dans les enseignants, la gratuité et l’égalité d’accès à l’éducation, mais surtout sur une conception humaniste du savoir (Sahlberg, 2011). La Finlande, souvent citée comme exemple, a construit son système sur la formation exigeante de ses enseignants : un professeur doit y obtenir un master avant d’enseigner. Cette exigence a créé une culture de compétence, de respect et de stabilité. Selon les rapports de l’OCDE, ce modèle a permis non seulement d’élever les performances scolaires, mais aussi de réduire les inégalités sociales, prouvant ainsi que l’école est un espace de justice avant d’être un lieu d’instruction (OECD, 2020).
Dans les pays émergents, l’expérience du Rwanda après le génocide de 1994 constitue une autre illustration puissante du rôle reconstructeur de l’éducation. Le gouvernement rwandais a compris que la réconciliation nationale passe d’abord par la salle de classe : en favorisant une éducation civique axée sur la tolérance, la paix et la citoyenneté, il a réussi à rebâtir un tissu social autrefois déchiré (Paul, 2017). L’école y a joué le rôle d’un espace symbolique de reconstruction du lien national, bien avant que l’économie ne retrouve sa vigueur.
Dans le monde arabe, le Maroc, fort de son histoire millénaire d’enseignement religieux et scientifique, se trouve aujourd’hui face à un défi crucial : transformer son capital éducatif en levier de réforme sociétale globale. Les universités et écoles traditionnelles comme la Qarawiyyine, fondée en 859 par Fatima al-Fihriya, témoignent d’une culture ancienne du savoir (Bennison, 2009). Cependant, le contexte actuel appelle à un réinvestissement dans la qualité pédagogique, la formation continue des enseignants et la revalorisation de leur statut. Car sans enseignant reconnu, il ne peut y avoir de réforme éducative durable. L’enseignement ne doit plus être perçu comme une charge publique, mais comme un investissement civilisationnel.
Dans le contexte des crises multiples — économiques, environnementales et identitaires — que traverse la planète, l’éducation se révèle comme un rempart moral et intellectuel. La philosophe Martha Nussbaum (2010) affirme que les sociétés qui négligent les humanités et la pensée critique produisent des citoyens techniquement compétents mais démocratiquement fragiles. De même, Amartya Sen (1999) soutient que la liberté réelle ne peut être atteinte sans l’accès au savoir : « le développement est avant tout un processus d’expansion des capacités humaines ». L’enseignement est donc le cœur battant du développement durable, car il construit des individus autonomes, conscients et capables de transformer leur environnement.
À cet égard, la formation de l’enseignant devient la pierre angulaire de toute politique éducative. Dans les pays où le statut social du professeur a été consolidé, comme au Japon, au Canada ou en Finlande, la qualité de l’enseignement a suivi naturellement (Barber & Mourshed, 2007). À l’inverse, dans les pays où le métier est précarisé, dévalorisé ou sous-payé, les réformes échouent malgré les investissements matériels. Le véritable changement se joue donc dans la reconnaissance du rôle social et symbolique de l’enseignant : il est le gardien du sens, le constructeur de la citoyenneté et le médiateur du savoir.
Les réformes éducatives réussies montrent également l’importance du lien entre école et société. L’éducation ne peut être isolée du contexte économique et culturel. Elle doit préparer les jeunes à la vie active tout en cultivant la pensée critique et la créativité. Singapour en est un exemple éloquent : son système éducatif a su concilier rigueur scientifique et innovation, discipline et flexibilité, formant une génération apte à s’adapter aux mutations technologiques rapides (Ng, 2017). C’est cette adaptabilité, fondée sur la compétence pédagogique et la culture de l’excellence, qui a permis au pays de se hisser parmi les leaders mondiaux en éducation et en innovation.
Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enseignant, il importe de rappeler que l’avenir des nations dépend de la manière dont elles traitent leurs enseignants. Comme l’affirme Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. » Ce n’est pas une métaphore poétique, mais une vérité historique et politique : aucune révolution durable, aucune réforme structurelle, aucune stabilité démocratique ne peut être envisagée sans une éducation solide et inclusive.
Ainsi, dans un monde traversé par la désinformation, les inégalités et la perte de repères, enseigner devient un acte de résistance et de construction. Célébrer les enseignants le 5 octobre, c’est rappeler qu’ils sont les artisans silencieux de la paix, du progrès et de la dignité humaine. L’enseignement n’est pas seulement la solution à nos crises ; il est la condition même de notre survie collective et de notre avenir commun (UNESCO, 2023).
Par Omar Lamghibchi