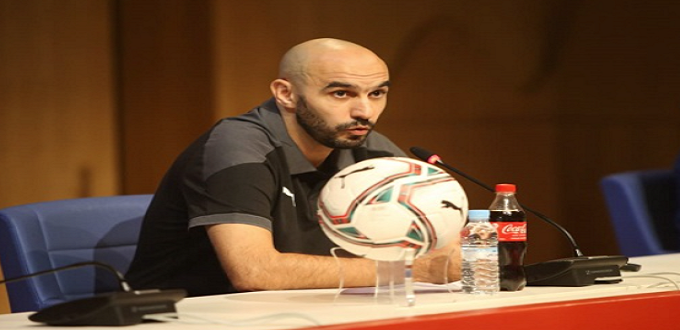Penser le transhumanisme : lecture critique de Ferry, Harari et Alexandre

La modernité technologique, dans son déploiement actuel, semble parvenir à un point de basculement où le projet humaniste hérité des Lumières entre en tension avec l’ambition posthumaniste de dépassement de l’humain par l’humain lui-même. Les développements convergents des nanotechnologies, des biotechnologies, de l’intelligence artificielle et des sciences cognitives produisent une nouvelle dynamique civilisationnelle, à la fois prométhéenne et incertaine, que plusieurs auteurs contemporains ont tenté d’examiner dans sa portée anthropologique. Parmi eux, Luc Ferry, Yuval Noah Harari et Laurent Alexandre proposent des visions qui, bien qu’inscrites dans des horizons épistémologiques et politiques différents, interrogent avec acuité les promesses et les périls de la révolution transhumaniste.
Chez Luc Ferry, le transhumanisme est interprété non comme une rupture brutale, mais comme un prolongement logique du projet moderne d’autonomie de l’homme. Il décrit ce moment comme une « révolution anthropologique », comparable en ampleur à celle du néolithique ou de l’imprimerie. L’auteur reconnaît la puissance des technologies NBIC dans la transformation de la condition humaine, notamment dans les domaines de la médecine régénérative, de la longévité et de l’augmentation cognitive. Toutefois, il se refuse à toute fascination techniciste. Il insiste sur la nécessité d’une régulation éthique et politique qui puisse encadrer les usages des technologies émergentes. Son approche repose sur une distinction importante entre un transhumanisme modéré, compatible avec les valeurs humanistes, et un posthumanisme radical, qui promeut la substitution de l’humain par des entités artificielles ou hybrides. Ferry tente de sauvegarder un espace de liberté et de responsabilité dans un monde traversé par des mutations accélérées, en appelant à une philosophie de la mesure, où le progrès technique demeure subordonné au progrès humain.
La perspective de Yuval Noah Harari, plus systémique et historique, s’inscrit dans une autre logique. Historien de formation, Harari examine l’évolution de l’espèce humaine à travers sa capacité à produire des récits collectifs structurants, et il considère que les récits religieux et humanistes sont aujourd’hui remplacés par les narrations techno-scientifiques. Dans Sapiens et surtout Homo Deus, il développe la thèse selon laquelle la quête contemporaine de santé, de longévité et de bonheur absolu constitue une nouvelle religion, fondée non plus sur la transcendance, mais sur la donnée. Le dataïsme devient, dans sa lecture, la doctrine implicite du XXIe siècle, où les algorithmes seraient mieux placés que les individus pour prédire et orienter les comportements. Harari ne se contente pas de décrire cette mutation : il en souligne les risques profonds. L’émergence d’une élite cognitive, dotée d’un accès privilégié aux technologies de l’augmentation, pourrait redessiner les hiérarchies sociales sur une base biologique et informationnelle. La promesse d’un Homo Deus, libéré de la mort et des limites corporelles, se double alors d’une inquiétude éthique : celle de la désintégration des principes de liberté, de responsabilité et d’égalité sur lesquels repose l’humanisme moderne. L’homme du futur, tout en étant biologiquement perfectionné, pourrait être ontologiquement diminué.
Laurent Alexandre, quant à lui, aborde ces questions avec la posture duale du médecin et du stratège technologique. Dans La Mort de la mort, il annonce l’avènement d’une médecine prédictive et réparatrice qui permettra de reculer considérablement, voire d’annuler, la mort biologique. Cette projection, à la fois enthousiasmante et controversée, repose sur les avancées de la génomique, de la thérapie génique et de l’IA appliquée à la médecine. Mais l’auteur ne s’arrête pas à cette dimension biologique. Dans L’IA va-t-elle tuer la démocratie ?, il développe une analyse plus politique, voire géopolitique, des enjeux de la révolution numérique. Il craint que la maîtrise des technologies cognitives ne soit accaparée par une minorité de puissances étatiques ou industrielles, provoquant une asymétrie de pouvoir telle qu’elle rendrait obsolète le modèle démocratique classique. Contrairement à Ferry, qui plaide pour un encadrement éthique, et à Harari, qui suggère une vigilance philosophique, Alexandre milite pour une mobilisation éducative massive, visant à doter les citoyens des compétences nécessaires pour résister à l’algocratie émergente. Son appel à une réforme cognitive de l’école comme contre-pouvoir à l’IA révèle une préoccupation centrale : celle de l’égalité d’accès à l’intelligence technologique.
Une lecture comparative de ces trois auteurs fait apparaître une convergence sur le diagnostic — la transformation radicale de l’humain par la technique est déjà en cours — mais une divergence dans la réponse à y apporter. Tous trois s’accordent à reconnaître le caractère irréversible des innovations technoscientifiques. Mais là où Ferry valorise une gouvernance éthique, Harari s’inquiète d’une perte de contrôle généralisée, et Alexandre propose une stratégie anticipative d’adaptation. Cette diversité d’approches reflète en réalité une tension constitutive du moment anthropologique actuel : entre pouvoir de transformation et crainte de la dépossession, entre promesse d’émancipation et menace d’aliénation.
L’enjeu n’est donc pas seulement technique ou médical. Il est profondément philosophique. Le transhumanisme n’est pas un simple courant idéologique marginal : il constitue le symptôme d’une crise plus large, celle des fondements du projet humaniste lui-même. En prétendant dépasser la vulnérabilité, la finitude, et même la mort, il redéfinit les catégories fondamentales sur lesquelles repose notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Or, cette redéfinition se fait souvent sans réel débat démocratique, dans l’opacité des laboratoires, des start-ups et des plateformes numériques. C’est ici que les sciences humaines et sociales retrouvent leur fonction critique. Loin d’être des disciplines dépassées, elles sont les seules à pouvoir penser ce qui se joue au-delà des protocoles techniques : la transformation du sens de l’existence humaine.
En définitive, la confrontation des visions de Ferry, Harari et Alexandre nous invite à interroger les finalités du progrès. Le transhumanisme peut-il être réconcilié avec les valeurs d’humanité, de solidarité et de liberté, ou bien nous conduit-il vers une ère post-humaniste gouvernée par les algorithmes et les bio-élites ? L’homme augmenté sera-t-il un homme accompli, ou un homme dissous dans ses prolongements technologiques ? Face à ces dilemmes, il ne suffit pas de maîtriser les outils : il faut encore — et surtout — s’interroger sur la destination. La question n’est pas de savoir ce que les technologies peuvent faire, mais ce que l’homme veut devenir.
Bibliographie :
• Ferry, Luc. La Révolution transhumaniste. Plon, 2016.
• Ferry, Luc. IA : Grand remplacement ou complémentarité ? L’Observatoire, 2019.
• Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. Harvill Secker, 2014.
• Harari, Yuval Noah. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Harvill Secker, 2016.
• Alexandre, Laurent. La Mort de la mort. Lattès, 2011.
• Alexandre, Laurent. L’IA va-t-elle tuer la démocratie ? Lattès, 2017.
• Floridi, Luciano. The Ethics of Information. Oxford University Press, 2013.
• Bostrom, Nick. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press, 2014.
Par Omar Lamghibchi / Historien