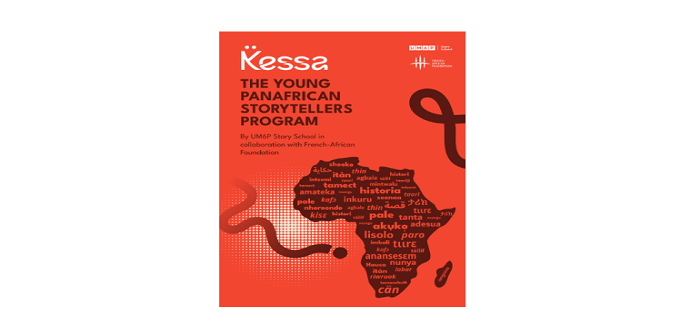(Billet 1142) – En ces jours incertains et imprévisibles, deux voix sages à écouter…

Les think tanks, ce sont des enceintes de réflexion qui, parfois, peuvent s’avérer utiles. Les gouvernements et les décideurs y ont de plus en plus souvent recours, ou devraient… La connaissance des faits et des origines et fondements des faits, la distance par rapport aux évènements et la sérénité de la réflexion des membres de ces organismes aboutissent à des idées, des conseils qu’il serait intéressant de considérer.
1/ Le revers du Maroc dans les instances de l’Union africaine. Durant le mois de février, une bataille électorale épique s’est tenue entre le Maroc et l’Algérie, pour être membre du Conseil Paix et Sécurité et pour la vice-présidence de l’UA. Le Maroc a perdu la seconde passe d’armes, et il est en passe de confirmer sa défaite dans la première. Est-ce grave ? Très certainement non dans le résultat en lui-même, mais plutôt oui dans l’analyse préalable qui a été faite des chances du royaume de l’emporter.
Dans un Policy Paper, Rachid Houdaïgui, chercheur au Policy Center for the New South (PCNS) et enseignant universitaire à Tanger, expose les tenants et les aboutissants de la candidature marocaine. Il explique que dans ce type d’aréopage africain, l’équilibre doit toujours être maintenu entre la prééminence d’un Etat et sa volonté de ne pas paraître ou être perçu en domination. Le fonctionnement des institutions et organes de l’UA sont de nature khaldounienne, montrant le parcours d’un pays qui aspire à la grandeur sur le continent, l’atteint et l’acquiert, en tire bénéfice au point de susciter les préoccupations des autres, qui lui préfèrent alors un autre, en se liguant contre lui. C’est ce qui semble s’être produit pour la candidature du Maroc à la vice-présidence de l’UA, en faveur de l’Algérie.
Très en retenue, le propos du chercheur montre que dans certaines configurations ou affrontements, la diplomatie gagnerait à prendre conseil auprès du monde académique, plus et mieux doté que l’appareil diplomatique à comprendre les structures de fonctionnement des organismes internationaux, et aussi moins soumis aux pressions diplomatiques usuelles.
2/ L’incertitude face à la politique internationale de Donald Trump. Entre la rupture d’alliances historiques et de coalitions pluri-décennales, la remise en cause de traités internationaux et des décisions économiques globales, la politique du président Donald Trump inquiète tous les gouvernements de la planète. Que cherche le président américain, et quel rôle jouent auprès de lui les magnats de la Big Tech ?
Répondant aux questions de nos confrères de Medias24.com, l’analyste économique Abdelmalek Alaoui, du think tank Institut marocain d'intelligence stratégique (IMIS), commente l’actualité internationale et met en garde contre l’effet d’aubaine que le Maroc pourrait distinguer dans les réactions aux décisions de Donald Trump, en espérant récupérer (glaner ?) des investissements ici et là. Abdelmalek Alaoui, avec beaucoup de sérénité, observe qu’ « avant de nous intéresser à la géopolitique, il nous faut continuer à travailler sur nous-mêmes pour être plus compétitifs, plus transparents et, in fine, construire un tissu industriel qui se base d’abord sur l’investissement national ». Une façon de dire que la culture du court terme, de l’opportunisme économique, du « détournement de commerce » comme il l’appelle, doit être évitée, pour s’ancrer dans une rationalité d’investissement et une solide volonté de produire marocain.
Cela a déjà été dit et redit, avec insistance : le Maroc ne dispose pas d’une classe entrepreneuriale créative et offensive, nous avons trop peu d’industries transformatrices et encore moins de brevets, nous avons une agriculture encore tributaire du ciel, nous avons une éducation nationale qui n’en finit pas de se chercher une voie de salut, et nous avons une douloureuse hémorragie de nos jeunes et moins jeunes talents. Réglons tout cela, remédions-y, pour disposer d’une base solide, avant de nous intéresser à la géopolitique et de tenter de nous immiscer dans la cour des Grands.
Dans un cas comme dans l’autre, les deux chercheurs revendiquent une sorte de retour sur soi, pas dans le sens de l’enfermement ou de l’autarcie, mais au contraire dans l’objectif de bien préparer ses ripostes aux convulsions du monde. Quand les relations internationales changent, que les équilibres des alliances explosent, que le commerce international est méchamment trituré, que le pays le plus puissant du monde devient imprévisible, alors il devient nécessaire d’étudier cela, d’examiner les nouvelles conditions, de peser le pour et de soupeser le contre.
Nous avons au Maroc bien des think tanks (comme l'Institut royal des études stratégiques, IRES, pour ne citer que lui) et des dizaines de chercheurs et de professeurs, d’anciens hauts fonctionnaires et de futurs grands universitaires, des prospectivistes et des économistes. Et nous avons l’Etat. Et dans tous les pays du monde qui s’en sortent et se déploient dans leur environnement et au-delà, le service public s’adosse à l’université et s’appuie sur la recherche, pour mieux comprendre ce qui advient et mieux appréhender ce qui suit.
Il manque au Maroc cette touche de savoir et de puissance de la connaissance empirique et/ou académique dans les arcanes et cercles de pouvoir. Quand on observe le mode d’action et de réflexion de notre gouvernement (rejetant tous les avis contraires ou simplement indicatifs des organes de gouvernance), ainsi que l’hermétisme de notre diplomatie au niveau central, on peut espérer qu’un jour prochain, l’Université et la Recherche seront impliquées et embarquées dans la définition et la mise au point des grandes politiques publiques du royaume.
Autrement, on continuera d’aller d’élection en élection, en attendant la prochaine, comme un mirage sans cesse renouvelé, dans l’espoir d’avoir enfin une majorité qui fasse sens. Et dans le monde tourmenté qui est devenu le nôtre, cela équivaudrait à une perte de temps.
Aziz Boucetta