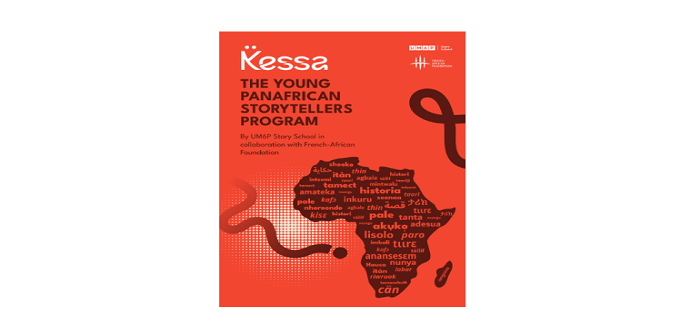(Billet 1189) – Un discours qui assure et rassure

Comme à chaque fois, le discours du Trône du roi Mohammed VI est une occasion de revenir sur l’année écoulée, ses acquis, ses réalisations et ses manquements. Ces discours, comme les autres d’ailleurs, sont à écouter mais surtout à lire avec soin ; les décideurs responsables y verront un satisfecit, ou pas, les citoyens comprendront mieux.
Au menu de ce discours, économie, social, territoires et diplomatie, le tout émaillé de petites phrases et grandes allusions.
1/ « Ce qui est à moi est à moi… ». Le roi commence par décrire les réalisations économiques et lister les grandes options stratégiques du Maroc. Ces acquis sont les siens, en vertu des pouvoirs qui qui lui sont conférés notamment par les articles 42 et 49 de la constitution. La « vision à long terme », c’est le roi, le NMD, c’est le roi, la sécurité et la stabilité, c’est toujours le roi. Les « orientations stratégiques » évoquées par le souverain ont permis un bond de géant dans les exportations et un essor remarquable dans les secteurs économiques qu’il cite, de l’automobile à l’aéronautique, en passant par les énergies renouvelables et l’agroalimentaire, mais il n’évoque pas le tourisme dans son discours, contrairement à la transcription écrite. Et l’agriculture ne figure pas parmi les leviers de l’économie marocaine émergente. Le roi y reviendra plus tard en parlant des retards accusés par le rural.
Sur le plan social, le roi Mohammed VI souligne l’importance de l’inclusion économique et rappelle son intérêt pour le développement humain, citant en exemples « la généralisation de la protection sociale et l’attribution de l’aide directe aux ménages qui y sont éligibles ».
2/ « … et le reste au gouvernement ». Et le reste, ce sont ces politiques publiques mises en œuvre et qui laissent une partie du pays sur le bord de la route, exclu des bienfaits du développement accéléré que connaît le Maroc. « Il est regrettable de voir que certaines zones, surtout en milieu rural, endurent encore des formes de pauvreté et de précarité, du fait du manque d’infrastructures et d’équipements de base ». Le grand absent du développement reste l’agriculture et le monde rural, et la charge royale est rude : « Cette situation ne reflète en rien Notre vision de ce que devrait être le Maroc d’aujourd’hui. Elle ne donne pas non plus la pleine mesure des efforts que nous déployons pour renforcer le développement social et réaliser la justice spatiale ».
Le constat d’inégalité spatiale, territoriale et humaine donne un Maroc qui avance à deux vitesses, et pour le roi, « il n’y a de place, ni aujourd’hui, ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses ». La marche des habitants de Aït Boughemez est encore dans les esprits… et à un an des élections et du blabla électoral, le constat est désastreux pour les responsables en charge de l’agriculture et de l’aménagement du territoire. On n’est même plus très loin d’une reddition des comptes.
3/ Les territoires, priorité à venir. Le chef de l’Etat a, une fois encore, enjoint au gouvernement « d’amorcer un véritable sursaut dans la mise à niveau globale des espaces territoriaux et dans le rattrapage des disparités sociales et spatiales », dessinant une véritable feuille de route tant qualitative que quantitative, détaillant les objectifs à cibler et les moyens à déployer. Cela n’a l’air de rien, mais le roi le rappelle quand même car avec ce gouvernement, il semblerait que les choses aillent mieux en disant et en répétant les choses.
Le programme tracé ressemble à celui de « Generation Green » lancé par le roi du temps du gouvernement ElOtmani et que devait mettre en place l’actuel. On attendra sans doute des résultats avec le prochain gouvernement, si la majorité change…
Cette injonction du souverain rappelle un peu sa démarche habituelle. Impliquer les institutions et les laisser remplir leur rôle, mais quand ce n’est pas le cas, le palais prend la relève et fait le travail. Ainsi des Moudawana 1 et 2, de la Régionalisation, du NMD ; le roi Mohammed VI avait demandé aux partis et aux institutions concernées de proposer les réformes nécessaires, mais devant leur incapacité ou leur incurie, il avait nommé des commissions spéciales. Doit-on attendre une commission pour le développement territorial ou pour les Marocains résident à l’étranger ? Sans doute…
4/ Les élections, c’est pour l’Intérieur. Les partis s’en défendent avec la dernière énergie mais le roi, lui, sait bien que la campagne électorale a déjà commencé. Si les partis, surtout ceux de la majorité, jouent le jeu et attendent janvier 2026 pour croiser le fer et lancer leurs machines à (vaines) promesses, le RNI, à son habitude, trace, sillonne, laboure le pays avec ses caravanes, ses slogans de campagne et son sans-gêne/sans-limite désormais légendaire. Or le RNI dirige le gouvernement. Le roi y a mis le holà, brutalement. Légaliste et respectueux des textes et des règles, le roi a confié les rênes électorales au ministère de l’Intérieur, avec un délai courant jusqu’à la fin de l’année pour faire adopter les textes pour ces élections.
Le ministère d’Abdelouafi Laftit est de tous temps chargé des élections, avec une certaine propension à monopoliser et sanctuariser son travail. Ssi Laftit est un ministre régalien et autonome, dit-on, mais avec cette onction royale, on peut lui faire confiance pour faire le job, indépendamment des chefs de partis qui l’entourent au gouvernement, et de leur chef.
5/ Algérie et « Union du Maghreb ». Le roi Mohammed VI insiste sur la main tendue à l’Algérie, répétant l’expression deux fois et appelant au dialogue sincère et exhaustif, sincère et fraternel. Ce n’est pas la première fois, formons le voeu que ce soit la dernière. Le souverain rappelle la profondeur des liens entre les deux peuples, la nécessité d’une construction régionale et l’étendue des perspectives possibles à deux, puis à cinq. Et, à propos des « Cinq » du Maghreb, notons que le souverain parle de « l’Union du Maghreb » et non de « l’Union du Maghreb arabe ». Ce n’est certes pas la première fois, mais cela est à relever.
Cette avancée vers l’Algérie est soulignée par cette phrase : « En ma qualité de Roi du Maroc, ma position est claire et constante : le peuple algérien est un peuple frère… ». Un rappel de l’évidence, en soin nom et en sa qualité de roi du Maroc, mais un rappel plus qu’utile à une période où les peuples commencent à s’attaquer mutuellement, directement, sur les réseaux sociaux, dans les forums internationaux… Un rappel en forme d’appel au calme adressé d’abord aux Marocains. Pas un mot des gouvernants algériens, parce qu’ils ne sont semble-t-il pas encore revenus de « l’autre monde » où ils ont élu résidence. Mais les peuples doivent se rapprocher, s’unir…
Le roi Mohammed VI, en disant cela, connaît la réalité des choses et utilise son sens de l’anticipation. Et ce sens dit que le dossier du Sahara approche de son issue, après les reconnaissances de la pertinence du plan d’autonomie marocain ou même de la marocanité des provinces du Sud. Parmi ces reconnaissances, celles d’Europe, comme le Royaume-Uni ou le Portugal, que le roi a remerciés, ou encore celles venues d’Afrique, essentielles aussi, avec le Kenya et le Ghana.
Le souverain semble dire aux gouvernants algériens que les choses étant prêtes d’être réglées, mieux vaut prendre le train en marche que rester sur le quai, mieux vaut s’associer à la logique et rejoindre la dynamique que se cramponner à une posture qui sera celle du vaincu. Dans l’esprit serein et pacifique de Mohammed VI, une victoire consensuelle et partagée est meilleure qu’un triomphe éclatant pour l’un et humiliant pour l’autre.
Un discours où le roi est égal à lui-même, un discours attendu qui rassure les Marocains, dans le fonds et la forme. Un discours qui clôt une saison et en lance une autre, cruciale. Un discours apaisé et ferme, optimiste et réaliste. Un discours que certains responsables devraient lire et relire…
Aziz Boucetta